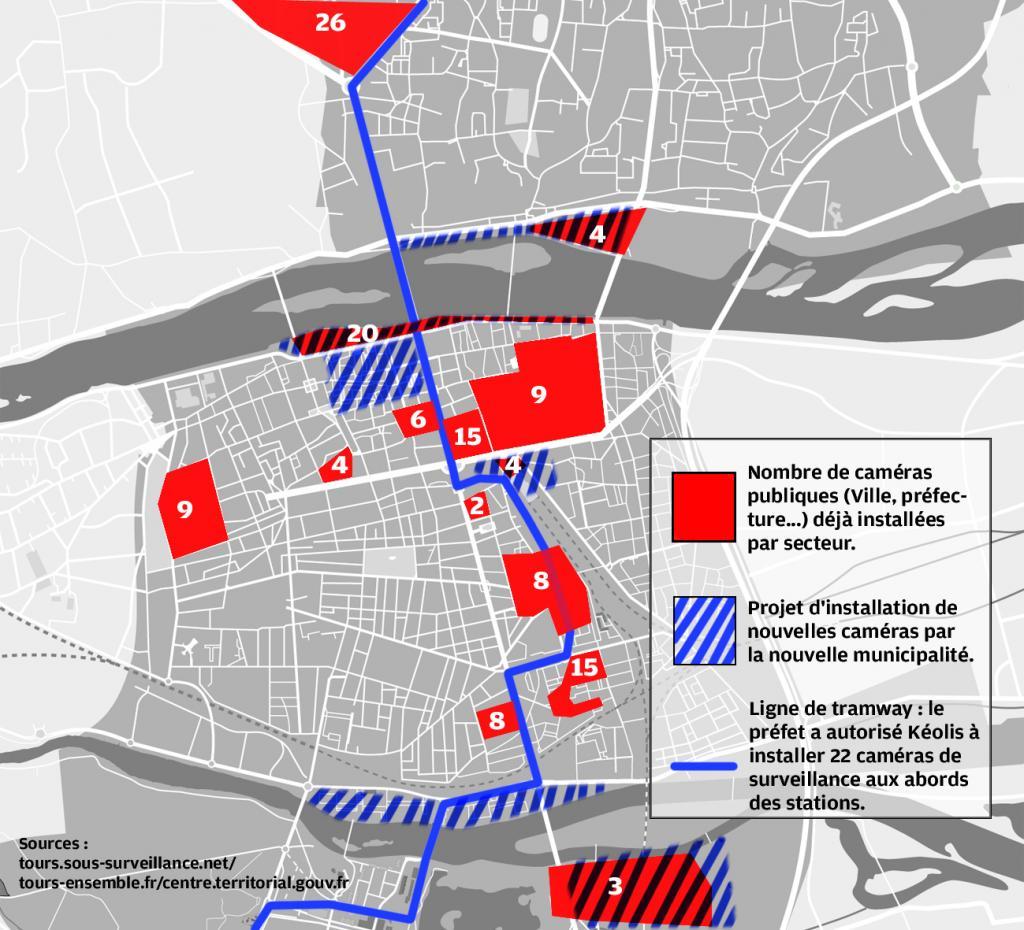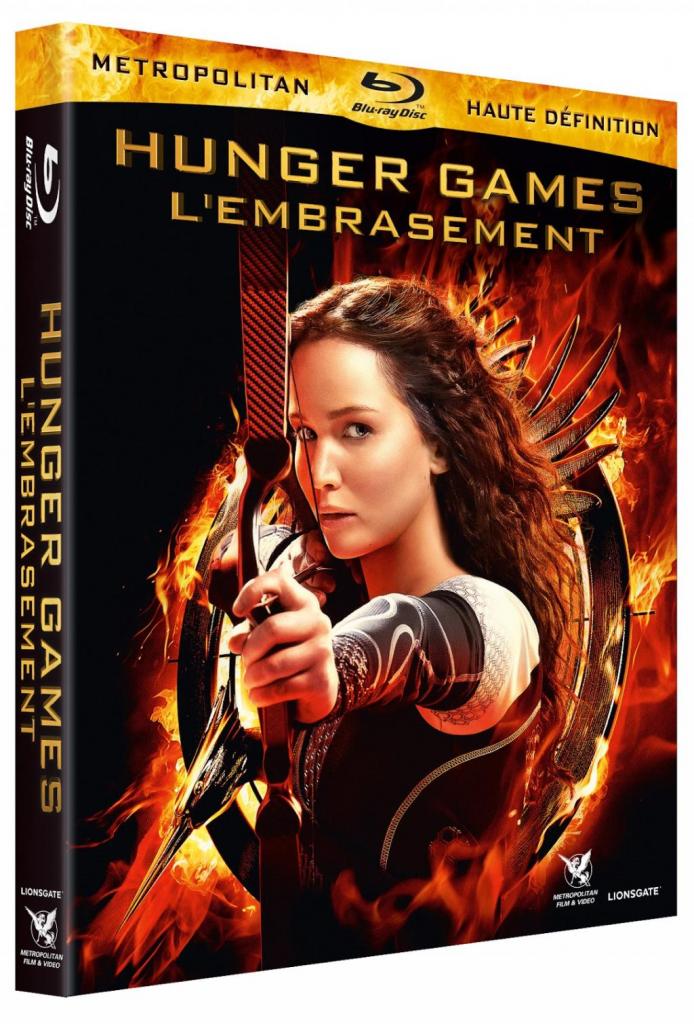Jeudi 2 avril : sea, sex and gore (et un ours tueur, aussi)

Bon. Cette année, soyons clairs : Mauvais Genre a la poisse. Ce jeudi, c’était Nuit interdite au CGR Centre, donc. Comprenez, quasiment toute une soirée et une nuit au ciné, à se goinfrer de films de dingue. Le principe ? Un long-métrage, un court, un long, un court… Sauf qu’un problème de son empêche les gens de rentrer, le temps passe, on prend du retard. Certains films auront aussi, pendant la soirée, de gros bugs. Mais c’est pas grave, tout le monde prend son pied, rigole, a le sourire aux lèvres (il y a beauuuucoup de monde). Pas de « Garyyy à poiiiil ! ». Je suis déçu, je tape un brin de causette avec Francis Renaud (on en parlait le jour 1), acteur fétiche d’Olivier Marchal.
Il me parle d’Il était une fois en Amérique, diffusé hier (un film culte pour lui), du cinéma français dans lequel il n’a pas que des amis (« à force d’ouvrir sa gueule », comme il dit). D’une sincérité désarmante, langage cash, mais d’une extrême gentillesse. Francis Renaud précise aussi qu’il planche sur son autobiographie en ce moment. « Crois-moi, ça va faire mal ! », prévient-il. « Tu vas taper dedans ? », je demande. « Oh que ouais. » Hâte. En ce moment, il est président du Jury pour Mauvais Genre, rédige donc son autobiographie (avec sa femme) et apprend ses textes. Dans quelques jours, il s’envolera de nouveau en Bulgarie pour un tournage de série. « Ça va être énorme », se réjouit-il.
>Bon, c’est pas tout, mais causons films. La soirée s’ouvre avec Liebre 105. Le court-métrage de Sebastián et Federico Rotstein. Une jolie donzelle enfermée dans un parking souterrain, poursuivie. Mais paf, problème de son : c’est-à-dire… pas de son du tout. Pas grave, quelqu’un dans la salle s’amuse à faire un doublage en espagnol par-dessus. La salle est hilare. Passé le souci technique, on découvre un court clichesque à souhait (nana aux gros seins, talon qui pète, lumières qui s’éteignent une par une, le portable qui ne capte plus…), mais étonnamment réussi, grâce à un humour bien dosé et le tout, bien ficelé.
>Suit Backcountry (compétition). Un film canadien d’Andy MacDonald, surprenant et très réussi, où deux citadins se paument dans les bois, mais vont rapidement se rendre compte que la nature est plutôt… sauvage. D’un côté, normal, y a aussi un ours bien décidé à les zigouiller. Montage énergique et nerveux, un peu gore mais pas trop, hommages appuyés à Jurassic Park (ah, le coup de la tente) et Les Dents de la Mer… Dommage pour ces mouvements de caméra rapidement agaçants qui filent la nausée.
>Deuxième court-métrage, Les Fines Bouches. Gros moment délire vintage de la soirée (merci d’ailleurs à toute l’équipe et aux réal’ Julien de Volte et Arnaud Tabarly, présents dans la salle) : une famille de zombies passe le temps en dézinguant du hippie pour le repas du soir. Le court, encore en post-prod (on a droit à une exclu), souffre d’un son encore mal équilibré et de quelques fautes dans les sous-titres (bah ouais, les zombies parlent un mix d’allemand et de langage mixé à l’envers). Mais il enquille les scènes hilarantes (la morale m’interdit d’en citer une ici…), faisant le plein d’hémoglobine et rendant hommage, à sa façon, à Romero et consorts.
>CADEAUUUUUU. Quand la lumière s’éteint et que la trombine de sieur George Miller (papa de Mad Max) apparaît, la salle hurle de joie. Petite surprise de Mauvais Genre : le réalisateur nous propose une version « extended » du trailer de Mad Max Fury Road. Classe ! Et c’est une pépite, une dinguerie. Visuellement, c’est sublime. Rendez-vous le 14 mai, car ça va faire très, très mal !

>Le temps passe et nous voilà devant l’anthologie México Barbàro. Qui dit film à sketches, dit séquences plus ou moins réussies. Dans l’ensemble, les huit réalisateurs brillent. On passe de l’ultra gore, au bizarroïde (Drain, au hasard), aux légendes aztèques flippantes, légendes mexicaines. Le tout dirigé par de jeunes talents sud-américains (va falloir lorgner de ce côté-ci de l’Atlantique !!). De l’horreur pure et dure, du fantastique, c’était délicieux (et parfois très rigolo).
Bon, il est 3 h du matin. Il reste encore un film, Dyke Hard (hors-compétition), qui devait être complètement fendard (un groupe de rock lesbien affronte fantômes et ninjas en se rendant à un concours de musique…). Mais il fallait être au travail le lendemain (oui, oui, je suis sérieux), donc dodo avec des images de la Nuit interdite plein la tête.
Pour se faire pardonner, voilà le trailer :
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=FhOjrRGUl5Y[/youtube]





















































 Concept simple, mais efficace : durant toute une nuit, tout crime est légal pour la population américaine ; c’est La Purge. On copie colle donc la formule du premier épisode, mais en extérieur cette fois-ci, dans les rues de Los Angeles, où tout le monde est donc décidé à faire sa loi. En touchant la corde sensible – les armes – American Nightmare 2 réussit déjà un peu plus là où son petit frère avait échoué : effleurer une véritable satire grinçante sur un sujet hautement explosif et 100 % made in USA. Malheureusement, le propos est rapidement amoindri, notamment par une désincarnation totale des protagonistes : tous sont absolument d’une platitude consternante, sans relief, voire carrément inexistants. Seul Frank Grillo, en flic revanchard plein de ressentiment, parvient à sortir la tête de cette bouillie de personnages pathétiques.
Concept simple, mais efficace : durant toute une nuit, tout crime est légal pour la population américaine ; c’est La Purge. On copie colle donc la formule du premier épisode, mais en extérieur cette fois-ci, dans les rues de Los Angeles, où tout le monde est donc décidé à faire sa loi. En touchant la corde sensible – les armes – American Nightmare 2 réussit déjà un peu plus là où son petit frère avait échoué : effleurer une véritable satire grinçante sur un sujet hautement explosif et 100 % made in USA. Malheureusement, le propos est rapidement amoindri, notamment par une désincarnation totale des protagonistes : tous sont absolument d’une platitude consternante, sans relief, voire carrément inexistants. Seul Frank Grillo, en flic revanchard plein de ressentiment, parvient à sortir la tête de cette bouillie de personnages pathétiques.


 UN PLAT
UN PLAT






 UN PLAT
UN PLAT