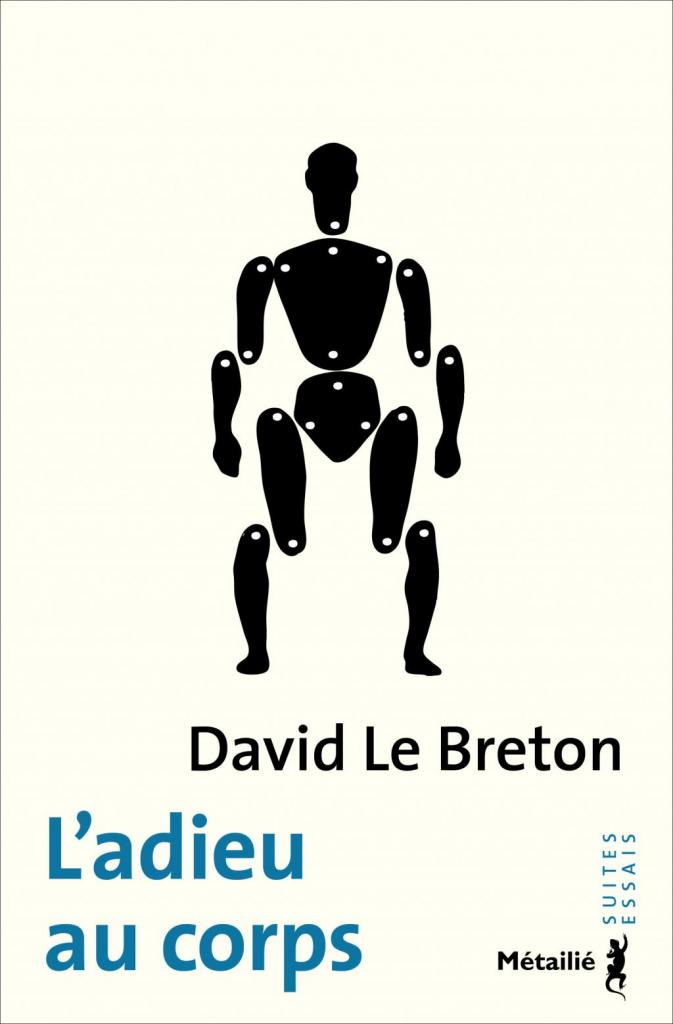Quel est votre rôle au CFA ?
Olivier Rouiller : À la sortie du collège j’ai fait un BEP tourneur-fraiseur puis un bac pro EDPI (étude et définition de produits industriels) ; ensuite un CAP horlogerie et un bac pro d’horloger. J’ai continué un an chez mon maître d’apprentissage en tant qu’horloger, puis j’ai été responsable de SAV pour 14 magasins du groupe français Le Donjon. Enfin, je suis arrivé au Campus des métiers où je suis formateur en pratique horlogère depuis quatre rentrées.
Adel Berrima : Je suis plutôt un pur scientifique. J’ai commencé à enseigner en prépa et j’ai décidé de venir travailler au campus il y a 16 ans. Mais je ne fais pas que des maths : j’enseigne aussi la techno, des cours de pratique en horlogerie et le multi-services en cordonnerie. J’ai donc continué à me former à des métiers manuels, je n’ai jamais quitté l’école.
OR : Même formateurs, on apprend toujours. Nous faisons un métier où on ne prétend pas qu’on connaît toutes les choses. On apprend toute notre vie. Et malheureusement, le jour où on saura tout, on ne sera plus ici.
Comment êtes-vous arrivés dans le monde de l’apprentissage ?
AB : Quand j’enseignais en lycée, quelque chose me manquait. On était profs, on savait tout, on avait juste à recracher notre savoir. Et c’était très frustrant. Je voulais absolument travailler avec des personnes qui avaient d’autres connaissances et me préoccuper de ce que je pouvais leur apporter en fonction de leur diplôme.
OR : À la sortie du collège, on parlait des classes techno, des lycées pro comme des endroits où aller quand on avait des difficultés. Mais moi j’ai toujours voulu faire quelque chose avec mes mains. Et c’est en lycée pro, lorsque j’ai effectué mes stages en entreprises, que j’ai entendu parler de l’apprentissage.
Quel regard porte la société sur l’apprentissage ?
AB : Comme matheux, scientifique, universitaire, le regard porté par la société est très négatif. L’apprentissage est toujours considéré comme une voie de garage : « Tu es mauvais, tu pars en apprentissage ». Mon regard à moi, c’est : « Tu es excellent, tu vas en apprentissage. Tu sais ce que tu veux faire, tu y vas, tu te formes et tu es employé directement après ».
OR : On entend souvent « Passe un bac avant et après tu feras ce que tu voudras ». Mais en apprentissage on peut passer un bac !
AB : Et avoir des diplômes supérieurs, jusqu’à un Master.
OR : Et là il n’y a plus la question de l’expérience quand on cherche un emploi, parce qu’on l’a en temps de formation.
Vous-mêmes, avez-vous eu à souffrir de ce regard ?
OR : Du côté familial, non. Des membres de ma famille sont artisans, je n’ai jamais eu de souci de ce côté-là. De mes anciens profs non plus car j’ai toujours voulu faire ce métier et quand j’ai envie de quelque chose je suis très borné. Et quand on me demandait « Apprenti ? Apprenti en quoi ? » je répondais en horlogerie. Or l’horlogerie, ça brille, c’est l’or, les diamants… C’est prestigieux.
AB : C’est plus compliqué en tant que prof de maths de dire qu’on va former des jeunes en apprentissage. C’est que quelque part on est un mauvais prof et qu’on se tourne vers les CFA ou autres établissements techniques parce qu’on ne peut pas faire le reste. Mais c’est peut-être qu’on a décidé d’enseigner autrement… En apprentissage, on ne peut pas se permettre qu’un enfant ne suive pas le cours. Notre rôle est là. Tout le monde peut avoir du mal à comprendre que quand on a des diplômes on accepte de perdre 300 € sur son salaire en décidant de venir enseigner dans un CFA et d’avoir moins de vacances scolaires. Oui, j’ai été critiqué : pardon, mais je m’en fiche.
OR : Le matin quand on se lève, on est contents de faire ce qu’on fait. Notre fierté, c’est les jeunes. C’est de voir où ils sont maintenant.
Quelle est la particularité de votre formation ?
AB : En apprentissage, cette formation est unique en France. C’est un métier de passion, on a des jeunes qui sont passionnés et qui adorent ce qu’ils font. C’est un métier historique avec du dessin d’art, énormément de calculs et d’engrenages, donc un petit côté ingénieur. Et chaque jour, en entreprise, nos jeunes ne savent pas sur quoi ils vont tomber : une montre qui a dix ans ou une horloge de 350 ans ?
Qu’est-ce qui motive les élèves et les patrons ?
OR : Quand ils obtiennent leur diplôme, nos élèves sont autonomes sur plein d’actions.
AB : Pour les apprentis, c’est un métier où l’on touche à tout, avec à 99 % une embauche derrière et un salaire correct. En ce qui concerne les patrons, il y a ceux qui cherchent à transmettre leur savoir pour ensuite transmettre leurs horlogeries ; et ceux qui ont besoin de main d’oeuvre mais ne trouvent pas de personnes qualifiées. Donc ils forment par apprentissage, ainsi ils auront pu tester la personne pendant deux, voire quatre ans.
Les élèves trouvent-ils facilement des entreprises ?
AB : Non. C’est très difficile de trouver un maître d’apprentissage. Déjà il faut que l’horloger fasse confiance en quelques minutes pour travailler avec un jeune dans un petit espace avec des pièces coûteuses. Ensuite il faut que les parents acceptent de laisser leur enfant partir à l’autre bout de la France pour faire sa formation. Le boulanger peut être à dix minutes de la maison. Pour l’horloger il y a très peu de chances que ce soit le cas.
OR : Nous on a une demande mais il n’y a pas assez de maîtres d’apprentissage. Et en plus il faut que ce soit au niveau national. On n’a qu’un apprenti de Tours et son patron est à Orléans. On avait deux maîtres d’apprentissage à Tours mais ils ont embauché leurs apprentis.
Et quel avenir pour les jeunes au sortir de cette formation ?
OR : Beaucoup sont embauchés par leurs maîtres d’apprentissage. Après, il y a les horlogers qui recherchent, certains partent à l’étranger… Et d’autres finissent dans le milieu aéronautique qui recherche leur profil parce qu’ils sont minutieux, ont la dextérité, savent travailler des micro-mécanismes avec des procédures bien développées.
Et devenir profs à leurs tour ?
OR : Oui, ça arrive. L’apprentissage est une façon de penser les choses, de transmettre et de pérenniser.
AB : Et qu’est-ce que c’est agréable quand on est formateur de voir arriver un enfant en situation d’échec et de l’emmener vers un diplôme — qu’il obtient, de le voir partir avec le sourire et trouver un emploi rapidement…
Sur la trentaine d’élèves horlogers du CFA, quelle proportion de femmes ?
AB : Je me souviens que quand Olivier était apprenti, en horlogerie, on avait très, très peu de filles. Aujourd’hui, elles représentent environ un tiers de nos élèves.
OR : Si vous tapez manufacture horlogère sur Internet, vous allez tomber sur de vieilles photos et voir des ateliers, avec des hommes sur des choses à complications, mais le reste de la manufacture, ce ne sont que des femmes. Parce qu’au départ on disait qu’elles étaient minutieuses, possédaient une dextérité particulière, donc on leur donnait des tâches bien précises et elles faisaient toujours la même chose.
AB : Mais ce n’est plus le cas. J’ai une ancienne apprentie qui, après avoir fait son bac pro chez nous, est aujourd’hui responsable production chez Patek Philippe. Et c’est une femme, et elle est passée par l’apprentissage. C’est une certaine fierté et il y a des fiertés qui n’ont pas de prix.
OR : On forme à un diplôme, mais aussi au monde professionnel.
Propos recueillis par Chloé Chateau
Photos : Chloé Chateau