Félicitations pour ce Prix ! Passons d’abord aux présentations et pouvez-vous nous dire comment vous en êtes venue à l’écriture ?
Je suis doctorante en sociologie, j’enseigne aussi à l’Université. Je donne des cours à Lyon 2. Quant à l’écriture, elle a toujours été là. À 10 ans, je voulais vivre de ça, mais je ne le disais pas, par peur qu’on se moque. Puis j’ai rédigé quelques nouvelles, envoyées à des concours. Le roman me faisait peur, mais j’ai fini par me lancer.
Accoucher d’un premier roman paraît insurmontable, vertigineux…
C’est terrifiant ! (rires) Ce qui fait peur, c’est que je savais que c’était indispensable. Je n’avais pas le droit d’échouer, c’était la seule chose que je ne pouvais pas rater : il fallait aller au bout. Dans les moments difficiles, je me disais que ma construction était trop ambitieuse. « Pourquoi j’ai fait ça ? Pourquoi il y a tous ces personnages ? Etc. » J’ai beaucoup douté, mais un très bon ami m’a justement dit que si je doutais autant, c’est que le résultat serait très bien.
Combien de temps a pris l’écriture ?
Entre trois et cinq ans, c’est dur à quantifier. Le prologue a été écrit en 2017, l’envoi à l’éditeur en mars 2020, et il a été accepté à l’été 2020. Mon éditrice souhaitait faire la rentrée littéraire. J’ai donc pris le temps de retravailler un peu, même si c’est un texte que j’avais en tête depuis longtemps. J’ai retrouvé une note d’intention de 2013 qui partait déjà en ce sens !
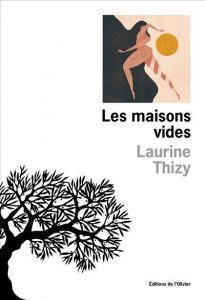
Dans Les Maisons vides, il y a une certaine mélancolie, une sorte de poésie sombre mais douce. Un peu comme l’âge adolescent en fait. Comment vous avez imaginé ce personnage de Gabrielle qui y contribue beaucoup ?
J’étais mélancolique quand j’étais ado. Comme beaucoup. Mais grandir, c’est ne pas laisser cette mélancolie nous envahir. Pour moi, le passé était plus gai que le présent. Là, je voulais un personnage adolescent qui soit universel dans son entêtement, sans crise de nerfs, car il n’y a ici pas de caprices. Mais elle s’oppose avec une rage contenue.
Gabrielle apparaît comme une taiseuse. Avec sa coach, son flirt, son amoureux, sa famille… La notion de « silence » imprègne le livre, non ?
Alors ça, ça me fait vraiment plaisir que vous me disiez ça ! (hum hum, le journaliste rougit – NDLR) C’est un roman sur le silence, oui. Un roman sur le début et la fin de la vie. Je parle des secrets de famille, quand on se parle de tout sauf de l’important. Ici, chacun a du mal à parler.
Pendant les premières pages, on ne sait pas trop qui raconte. Il y a aussi cette structure en flashback, alternant passé et présent, il y a les passages sur les clowns… Déstabilisant, puis tout se met en place et on se retrouve happés, littéralement. Vous vouliez éviter la facilité d’une structure commune ?
C’est vrai que c’est risqué, mais j’adore les constructions narratives surprenantes. Je ne voulais évidemment pas ennuyer ou perdre le lecteur, il fallait que ça ait un sens, qu’il se cogne à l’incompréhension, qu’on sente que quelque chose se trame… C’est souvent ce qui arrive dans la vie : quand on sent que quelqu’un a un lourd secret, mais qu’on ne sait pas trop tant le tabou est verrouillé. Cette construction était nécessaire, car le personnage de Gabrielle est farouche.

Votre écriture est très belle. Certaines phrases sont marquantes (ce « têtard remuant en passe de devenir une minuscule poupée » pour décrire le fœtus), tout est fluide. Comment décririez-vous votre style ?
Ouh, c’est très dur ! (rires) Je ne me sens pas encore assez « grande » pour dire que j’ai un style. Mais côté inspirations, on trouve Duras bien sûr pour son extériorité ; Kundera pour sa distance avec les personnages, ou Albert Cohen pour les envolées amples.
Les Maisons vides finit sur un uppercut, comme un twist au cinéma. On ne dévoilera évidemment rien aux lecteurs ! Mais saviez-vous dès le départ quel chemin vous alliez prendre ?
Je savais où j’allais, mais pas par quel chemin ! Je tenais à ce que le lecteur, en refermant le roman, se dise : « Oh bon sang, il faut que je relise tout depuis le début ! » (rires) Un peu comme dans Fight Club, Shutter Island ou Le 6e Sens au cinéma. Mon livre est très cinématographique en fait. J’ai des images quand je mets en mots. Concernant les chapitres avec les clowns, je jouais parfois la scène dans ma tête, à mimer les yeux fermés… jusqu’à ce que quelqu’un rentre dans la pièce et me demande ce que je fais ! (rires)
Tout du long, on a aussi cette notion de mutation du corps, qui change, évolue. En même temps, un de vos domaines de recherche en tant que doctorante est la sociologie du genre, du corps et de la sexualité. Tout est lié ? Ce thème est central chez vous ?
Oui ! Ça m’intéresse, c’est évident, et il y a une cohérence, mais c’est étrange et difficile de dire d’où ça vient. On peut expliquer plein de choses avec le corps. Un corps est vulnérable. C’est votre premier roman.
Quelles ont été les difficultés pour l’écrire ?
Le projet semblait compliqué au début. J’avais peur de perdre mon lecteur, je ne savais pas comment raconter un personnage. Il fallait que j’apprenne à faire la différence entre l’histoire et le récit, et comment faire passer le temps. C’est toujours dur de savoir quoi raconter et qu’est-ce qu’on ne raconte pas. Je suis universitaire de formation, donc très analytique. Là, pour un roman, on mélange des couleurs pour en faire un dessin.
Propos recueillis par Aurélien Germain / (Photo Patrice Normand /éditions de l’Olivier)
> Les Maisons vides, de Laurine Thizy (éditions de l’Olivier). 272 pages.




