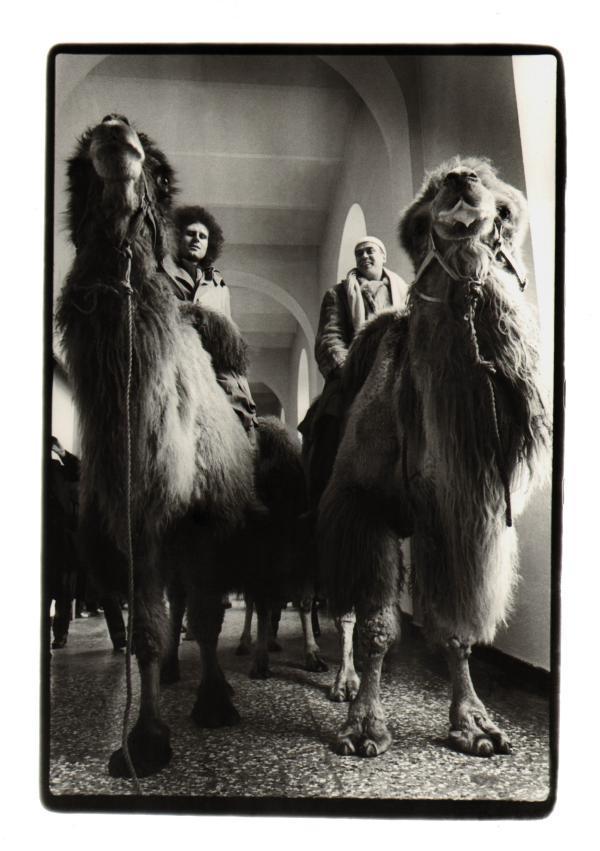Mardi, le musée est fermé mais Éric Garin, notre guide particulier nous attend. Diplômé en histoire de l’art et conférencier, Éric travaille au musée depuis 2002. Dire qu’il est passionné par le lieu est faible, il en parle avec une telle verve qu’on lui conseillerait de lancer sa chaîne YouTube. Succès assuré !
Éric connaît le bâtiment et beaucoup de ses secrets, mais nous explique-t-il, cette histoire est pleine de trous : les archives ont été brûlées en 1792 sur le parvis de la cathédrale, ce qui en restait sera achevé par les bombardements de 1940. Depuis, il tente de reconstituer la longue histoire du palais des évêques de Tours. Nous entrons d’abord dans le souterrain qui nous plonge dans le passé gallo-romain de la ville. Le palais épiscopal s’appuie contre le rempart du IVe siècle ; la société de consommation n’étant pas encore née, ses constructeurs l’ont bâti avec des pierres récupérées à droite et à gauche.

On peut ainsi reconnaître un tronçon de colonne ou le fronton de temple gallo-romain. Le mur semble fait de bric et de broc mais il résiste depuis quinze siècles, malgré quelques fissures. Si cette galerie est ouverte à la visite une fois par mois, la cave reste cachée au public. Les Allemands la transformèrent en bunker et y installèrent leur central téléphonique pendant la Seconde Guerre.
« D’autres parties du bâtiment ont subi des reconversions un peu rock’n’roll », nous explique Éric en quittant les catacombes. Ainsi, les cuisines n’abritent plus de marmites ni de cochons rôtis mais l’atelier d’encadrement. Même surprise dans la chapelle privée des évêques. Commandée à Louis de Galembert vers 1865, c’est une belle vitrine de l’art religieux tourangeau. Les vitraux sont signés de la célèbre manufacture Lobin, le plafond en coupole présente des mosaïques dorées à la mode byzantine, très en vogue à la fin du XIXe siècle, et les portraits des premiers prélats de Tours : Baldus, Volsinus, Perpetus (notre préféré, parce qu’il a l’air gentil).
La pièce héberge aujourd’hui la collection de dessins, conservés dans de grands cartons noirs. Éric souligne : « Nous avons plus de 5 000 dessins, des Boucher, des Werner, des Delacroix… »
17 000 pièces dans les réserves
Le musée regorge de trésors cachés de toutes les époques, dont beaucoup ne sont jamais exposés, faute de place. Plus de 17 000 pièces dorment dans les réserves : argenterie, faïences, fauteuils, commodes, tableaux, sculptures, lustres, horloges, vases et même une armure japonaise.
Les Beaux-arts fournissent d’ailleurs la préfecture ou les services de l’État en meubles et objets de décoration. La majorité des collections sont conservées dans les nouvelles réserves à Chambray mais quelques pièces sont encore entreposées dans la salle du synode, qui attend d’être rénovée pour être rouverte au public. Cette pièce bordée de colonnes accueillit les États généraux du royaume en 1468 et 1484. Sa hauteur sous plafond permet d’y accrocher des tableaux monumentaux et d’y organiser des concerts. Il fait bon, dans la chapelle colorée et lumineuse mais pas question de rester traîner à feuilleter les croquis et les sanguines.
Nous retraversons le bâtiment, découvrons un escalier dérobé caché dans le plancher puis Éric ouvre une petite porte et nous quittons les coulisses pour déboucher dans une salle du musée, juste dans le dos d’un petit tableau carré enchâssé dans une niche. C’est un Rembrandt, l’un des joyaux du musée. À peine le temps de le photographier et d’admirer une grisaille accrochée à sa droite, notre guide nous entraîne jusqu’au grenier. Là, sous la charpente du XIIe siècle, des rangées de cadres dorés attendent leur heure. « Restez bien sur les solives, nous prévient Éric. Un gardien s’est tué en passant à travers le plancher. »
 Les statues oubliées nous regardent marcher sur les poutres comme des enfants de 5 ans en cours de gym. Tout est silencieux. La vue sur le jardin est magnifique. Presque quatre heures déjà que nous explorons les lieux. Même si notre rêve serait de passer la nuit au musée, il faut partir. Au-détour d’un couloir, nous apercevons un échafaudage : Catherine Pinvert, la régisseuse, et deux employés des services techniques de la Ville s’affairent à réinstaller des oeuvres. Il faut compter une à deux journées de travail par salle pour leur rendre leur visage originel après une exposition temporaire.
Les statues oubliées nous regardent marcher sur les poutres comme des enfants de 5 ans en cours de gym. Tout est silencieux. La vue sur le jardin est magnifique. Presque quatre heures déjà que nous explorons les lieux. Même si notre rêve serait de passer la nuit au musée, il faut partir. Au-détour d’un couloir, nous apercevons un échafaudage : Catherine Pinvert, la régisseuse, et deux employés des services techniques de la Ville s’affairent à réinstaller des oeuvres. Il faut compter une à deux journées de travail par salle pour leur rendre leur visage originel après une exposition temporaire.
À l’inverse, au rez-de-chaussée, les techniciens et les organisateurs préparent l’exposition Sculpturoscope, réalisée en partenariat avec le Centre d’études supérieures de la Renaissance (CESR) et le Laboratoire d’Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT). La majesté de la salle Richelieu nous arrête une dernière fois. Les peintures de batailles, la table massive, les bustes antiques… Il nous semble entendre le son du canon et le claquement des bottes du Cardinal. Travailler au musée, c’est baigner dans cette ambiance hors du temps, naviguer entre la collection de primitifs italiens et les installations de Calder exposées au dernier étage.
Éric, qui a longtemps travaillé sur le bureau de Georges Courteline himself, aime ce voyage incessant. « Tout est intéressant. Même les périodes dites de régression ou le style “ pompier ”. C’est tellement humain ! Quand l’homme disparaît, la peinture, la sculpture, l’architecture, sont ce qui nous reste et qui nous raconte son histoire. »
> Le musée est ouvert tous les jours, de 9 h à 12 h 45 et de 14 h à 18 h. Fermé le mardi.
Texte : Elisabeth Segard
Photos : Julien Pruvost